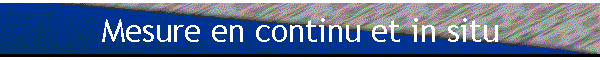
|
|
|
Mesures
en continu et in situ des traceurs par des capteurs chimiques. Application à l'ion iodure par Bruno Ducluzaux EKS Hydrogéologie, Le Morgon, F-69640 Lacenas Abstract This paper presents the water tracing with
continuous and on site measurements of the ionic tracers by chemical sensors. Continuous traces give tracer breakthrough
curves and Residence Time Distributions (RTD) with a high degree of accuracy. The detector used is an autonomous (3
years) and submersible (100 meters) chemical probe. The most used tracer is ion iodide. Multi-tracings, ion iodide and
ion potassium can be carried out. The principle of interpretation is the detection of a peak of concentration in the
tracer compared to the background noise recorded by the apparatus. In clean water, the sensitivity of detection is
usually a few micrograms per liter for the iodide. In 6 years, 170 artificial tracings were carried out with chemical
sensors. Résumé Cet article présente les traçages avec des mesures en continu et in situ des
traceurs ioniques par des capteurs chimiques. Les traçages en continu permettent d'obtenir des courbes de restitution
et des Distributions des Temps de Séjour (DTS) d'une grande précision. Le détecteur utilisé est une sonde chimique
autonome (3 ans) et immergeable (100 mètres). Le principal traceur utilisé est l'ion iodure. Des multitraçages, ion
iodure et ion potassium, peuvent être réalisés. Le principe d'interprétation est la détection d'un pic de
concentration en traceur par rapport au bruit de fond enregistré par l'appareil. Dans les eaux propres, la sensibilité
usuelle de détection est de quelques microgrammes par litre pour l'ion iodure. En 6 années, 1. Introduction La mesure en continu et
in situ des traceurs permet d'obtenir des courbes de restitution d'une grande précision, Certaines techniques de
traçages en continu sont utilisées depuis longtemps : ·
La mesure du traceur sel par la conductivité électrique depuis le début
du 20ème siècle. ·
La mesure des traceurs radioactifs par la radioactivité, Molinari
(1976). ·
La mesure des traceurs fluorescents par des fluorimètres in situ, Molinari
(1976), Smart (1988), Meus et al.
(1997). D'après une synthèse
des applications des traceurs artificiels à la protection des ressources en eau publiée en 1996 par le CEA, il
n'existe pas de méthode, validée et utilisée, de détection "in situ" des traceurs chimiques. Les prélèvements
d'échantillons d'eau sont obligatoires, Vitart & Calmels
(1996). La technique présentée
dans cet article concerne la surveillance en continu et in situ des traceurs ioniques (ou "chimiques") par des
capteurs chimiques. Ce procédé de traçage a été mis au point en 1995. L'utilisation du traceur ion iodure avec le
capteur chimique correspondant est décrit avec précision. 2. Matériels et méthodes de mesures des
traceurs par des capteurs chimiques Le matériel utilisé
est une sonde autonome et immergeable sous 100 mètres d'eau (fabrication en aluminium, acier inox ou PVC pression, matériaux
agréés alimentaires). L'autonomie énergétique de la sonde est au moins de 3 ans. La mémoire
informatique est non-volatile, c'est à dire que même si la batterie se vide totalement, les données enregistrées
sont toujours récupérables. La sonde mesure et enregistre également
la température avec une résolution de 0,03 °C. La mesure est
proportionnelle au logarithme de la concentration. Quelle que soit la concentration, de 1 µg/l à Des courbes de
restitution en écoulement naturel dans un milieu poreux alluvial ont été analysées finement (distances de 250 à 800
mètres entre les forages d'injection et de surveillance). Dans ces conditions favorables, le capteur iodure détecte
sans ambiguïté une augmentation de concentration de 0,01 µg/l. La relation entre la
valeur enregistrée par la sonde et la concentration réelle peut être réalisée par plusieurs méthodes : ·
Étalonnage en laboratoire de la sonde chimique. Des appareils et des procédures
spécifiques d'étalonnage ont été développés. ·
Étalonnage en laboratoire par des mini-traçages réalisés dans des
conditions parfaitement connues. ·
Analyses en laboratoire agréé et certifié d'échantillons d'eau prélevés
près du capteur chimique. Fig.
1
: Deux courbes de restitution normées obtenues avec le capteur chimique iodure. Mêmes points d'injection et de
surveillance. Conditions hydrodynamiques différentes. Une mesure toutes les minutes. Concentrations au maximum des pics
: 80 à 90 µg/l En combinant les trois
méthodes précédentes, il est possible d'arriver à une précision de 1 % sur la concentration absolue (précision
d'une mesure = exactitude ¹
résolution). Le principal intérêt
de la mesure précise de la concentration est le calcul du taux de restitution. Or il est également nécessaire de
mesurer le débit pendant toute la durée du traçage avec la même précision. Le débit exact d'une source karstique
est particulièrement difficile à mesurer : turbulences pendant les jaugeages au micro-moulinet, fuites en basses eaux,
trop-pleins pendant les crues. Une précision meilleure que 5 % est exceptionnelle. Il est donc étonnant de voir des
bases de données où les taux de restitution sont donnés au pour cent près alors que le débit a seulement été
estimé à un instant donné. Pour les traceurs
conservatifs comme l'ion iodure, nous sommes arrivés au résultat suivant. Le taux de restitution dépend
principalement de la méthodologie d'injection, donc d'un élément extérieur au système à étudier. Cela nous
conduit à ne pas accorder trop d'importance au taux de restitution, et à normer la courbe de restitution par rapport
à la masse restituée et non par rapport la masse injectée. Les applications
scientifiques du procédé de traçage sont libres et sans aucune restriction pour les chercheurs. En France, les
applications commerciales sont protégées par un brevet. Le marque déposée de la technique de traçage est Traceautoâ. 3. Application à l'ion iodure L'ion iodure est le principal traceur utilisé avec les capteurs chimiques, Fig. 1. Les principes et les précautions d'emploi sont détaillés ci-dessous. Les analyses, ainsi
qu'une centaine d'étalonnages des capteurs iodure, montrent que la sensibilité de détection de l'ion iodure dans les
eaux propres atteint généralement quelques µg/l. Un pic de concentration de 10 µg/l est facilement interprétable.
Dans des conditions favorables, c'est-à-dire avec un bruit de fond faible, une augmentation de la concentration en
iodure de 0,01 µg/l est détectable (par exemple, sonde chimique placée dans un forage d'une nappe alluviale). L'iodure de sodium est
extrêmement soluble dans l'eau : 1,8 kg de NaI se dissolvent dans 1 litre d'eau. C'est d'ailleurs la raison pour
laquelle l'ion iodure est sans doute le meilleur traceur de l'eau. L'injection de l'iodure de sodium dans un minuscule
filet d'eau sur un karst est réalisable pratiquement sans modifier le débit naturel. L'iode utilisé est de
qualité pharmaceutique, c'est à dire d'une qualité supérieure à la qualité alimentaire. Il a une pureté supérieure
à 99 %. L'iodure de sodium est moins toxique que le sel de cuisine. La toxicité aiguë au point d'injection est donc faible. Aux points de
restitution, la toxicité, aiguë et chronique, est inexistante. En effet, l'ion iodure est un oligo-élément
indispensable à la vie. Notre alimentation a en général une carence en iode. Boire de l'eau pendant un
traçage est donc bénéfique pour la santé. En France, la carence en iode est
compensée en rajoutant de l'iodure de sodium dans le sel de cuisine, avec une concentration de 10 mg/kg. Le lait pour bébé
a une concentration en iodure de 130 µg/l, c'est-à-dire une concentration bien supérieure à la concentration
maximale de restitution de nos traçages (entre 10 et 80 µg/l normalement). Dans les captages traités
au chlore, les traçages à l'iode doivent utiliser des techniques d'analyses performantes (capteurs chimiques en
continu ou autres techniques de laboratoire). L'emploi d'une méthode d'analyse moins sensible (chromatographie ionique,
électrode spécifique en laboratoire) conduit obligatoirement à une odeur dans l'eau, si une restitution est détectée.
En effet, le seuil de détection de ces méthodes (100 à 500 µg/l) est supérieur à la limite de réaction entre
l'iodure et le chlore. 4. Résultats des traçages artificiels et
naturels Les traçages
artificiels sont définis comme des opérations de traçages avec une injection artificielle de traceur par l'opérateur.
Le traceur peut être un composé naturel de l'eau, comme l'ion iodure. Le point d'injection et le point de surveillance
doivent être distincts et suffisamment éloignés. Suivant cette définition, 170 traçages artificiels ont été
effectués avec le procédé. Les traçages
successifs, avec les mêmes points d'injection et de surveillance, sont réalisables, Fig. 1 et Avec cette méthode,
nous avons réalisé facilement sur des sources karstiques plusieurs dizaines de traçages. Les applications de ces traçages
répétés sont nombreuses, en particulier la détermination des volumes statique et dynamique d'un système karstique,
Smart (1988).
Fig.
2
: Trois courbes de restitution normées (DTS à débit constant) sur un même système traçage. Source karstique de débit
moyen 130 l/s. Concentrations au maximum des pics : 20 à 80 µg/l en ion iodure. Les traçages naturels
ne comportent pas d'injection artificielle de traceur par l'opérateur. Le traceur utilisé peut être naturel ou
artificiel. Avec les sondes chimiques, nous avons utilisé des sites pollués ou des décharges lessivés par des
orages, des largages de Canadair avec de l'eau de mer, des salages de routes en hiver. L'avantage des traçages
naturels est leur caractère reproductible Il suffit de laisser la sonde chimique suffisamment longtemps, en général
un ou deux ans. Un exemple d'application des
traçages naturels est donné en Fig. 3. Le traceur utilisé est l'ion chlorure
des salages de routes. En 2 hivers, 6 courbes de restitution ont été obtenues
sur une source karstique, de débit moyen 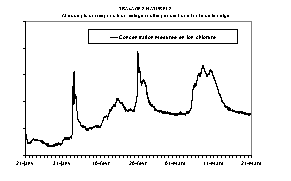 Fig.3 : Courbes de restitution de traçages naturels (salages d'une route)
Fig.3 : Courbes de restitution de traçages naturels (salages d'une route)
Les services de l'équipement
nous ont confirmés que les salages étaient uniquement curatifs lorsque la neige
avait déjà commencé à fondre (pas de salage préventif ou lorsque qu'il fait trop
froid). Les injections de sels sont donc ponctuelle et facile à retrouver à
partir des données météorologiques et de l'équipement. 5. Conclusion Cet article a présenté
la technique de mesure des traceurs par des capteurs chimiques. Cette technique a été expérimentée pendant six années
dans des milieux et des conditions les plus diverses. En milieu karstique, le procédé est bien au point, il permet
d'obtenir des courbes de restitution de grande qualité. En milieu fissuré ou
poreux, les traçages forage-forage en écoulement naturel sont d'une technicité nettement supérieure. En effet, les
forages d'injection et de surveillance doivent être choisis après une étude hydrogéologique détaillée, comprenant
une reconnaissance géophysique pour déterminer les cheminements d'écoulement préférentiel de l'eau. Les traçages
entre forages implantés uniquement d'après la piézométrie conduisent pratiquement toujours à des échecs. Cette
technique a permis la réalisation de traçages en écoulement naturel entre forages dans une nappe polluée contenue
dans des sables argileux et sous un site industriel en activité. Le procédé de traçage fonctionne donc dans les
conditions les plus difficiles et les plus complexes. Les traçages en milieu karstique sont en comparaison extrêmement
simples : eau propre, points d'injection (perte) et de surveillance (sources) évidents, interaction avec le milieu
souterrain quasi nulle. Références Dematteis A., 1995. Typologie
géochimique des eaux des aquifères carbonatés des chaînes alpines d'Europe centrale et méridionale. Thèse N°
1419, Lausanne, Ducluzaux, B.,
1999. Mesure en continu et in
situ des traceurs pour les traçages artificiels et naturels. Interprétation des courbes de restitution perturbées par
des précipitations. Actes Neuvième Rencontre d'Octobre, Paris, France. Lepiller M. & Mondain P.-H.,
1986 : Les traçages artificiels en hydrogéologie karstique. Hydrogéologie, n°1, 1986, p.32-52. Meus P., 1993.
Hydrogéologie d'un aquifère karstique dans les calcaires carbonifères (Néblon-Anthisnes, Belgique). Apport des traçages
à la connaissance des milieux fissurés et karstiques. Thèse Université d'Etat de Liège. Belgique, 323 p. Meus P., Bakalowicz M., Käss W., Barczewski B. &
Schmid G., 1997. Perspectives offertes par la mesure en continu des traceurs
fluorescents dans le karst. 6th Conference on Limestone Hydrology and Fissured Media, la Chaux-de-Fonds,
Suisse, 10th-17th August, 1997. Molinari, J.,
1976. Interactions avec le milieu et développements récents dans l'emploi des traceurs artificiels – La
houille blanche, N°3/4 - 1976 - Grenoble. Smart, C.C.,
1988. Quantitative tracing of the Maligne karst system, Alberta, Canada - Journal of Hydrology , 98:
185-204,.7 fig. - Elsevier, Amsterdam. Vitart X. & Calmels P. 1996. Les
applications de traceurs artificiels au service de la protection des ressources en eau. L'eau, l'industrie, les
nuisances, N° 194 , Paris. |